Il est temps de mieux protéger nos forces de police
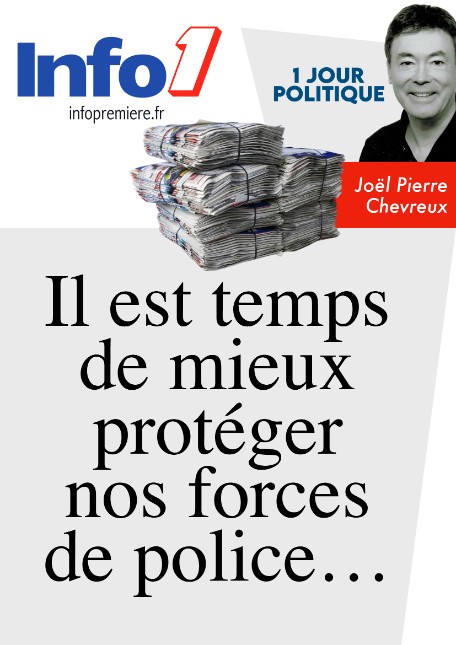
Il est temps de mieux protéger nos forces de police...
Il est temps de mieux protéger nos forces de police Entre violences urbaines, trafics de drogues et menaces individuelles, nos policiers et gendarmes sont malmenés tant par des hordes de jeunes incivilisés que par… la justice ! Il est temps que les membres de nos forces de l’ordre puissent voir leur travail respecté !
Quatre individus ont été interpellés
Hier, jeudi, encore, lors d’une opération antistupéfiants, plusieurs policiers ont reçu des jets de pierres au quartier des Valmeux, à Vernon (Eure). Tirs de mortiers, pluie de pierres, grenades lacrymogènes, véhicules dégradés, ce nouvel épisode de violences urbaines devrait inviter notre gouvernement et l’ensemble de la caisse politique à mieux soutenir Bruno Retailleau dans ses actions et sa vision du phénomène. Quatre individus ont été interpellés. Parmi eux, un jeune homme âgé de dix-neuf ans connu de la police pour des faits similaires et deux mineurs qui, âgés de dix-sept. Ils avaient attaqué les policiers de la Bac. Placés en garde à vue et… libérés, la procédure a été transmise au parquet. Dès lors, il convient de s’interroger : Pourquoi nos policiers ne sont-ils pas mieux protégés ? Pourquoi la justice relâche-t-elle des individus multirécidivistes, quelques heures à peine après leur interpellation ?
Garantir une meilleure protection à nos forces de l’ordre.
Pris en étau entre les violences urbaines, réseaux de trafiquants et attaques ciblées, nos policiers et gendarmes se retrouvent seuls, pris pour cible par des groupes hostiles, mais aussi par une justice qui peine à suivre. Leur engagement mérite respect, soutien et cohérence institutionnelle. Quatre individus interpellés au cours de cette intervention. Tous placés en garde à vue… puis relâchés. La procédure a été transmise au parquet. Dès lors, une double question s’impose : pourquoi ceux qui risquent leur vie chaque jour se voient-ils si peu protégés ? Et pourquoi la justice remet-elle si rapidement en liberté des individus récidivistes, parfois à peine interpellés ? Ces décisions répétées alimentent une perte de sens, un découragement profond chez nos forces de l’ordre — et une inquiétude croissante au sein de la population. Ces deux questions hantent l’opinion. Elles nourrissent le désarroi des forces de l’ordre et attisent une colère sourde dans les rangs de ceux qui, chaque jour, affrontent la violence et l’imprévisibilité du terrain.
La République tient par ses piliers
École, Santé, Justice, Sécurité. Mais que reste-t-il d’un pilier quand ses fondations vacillent, quand ceux qui le soutiennent se sentent trahis, méprisés ou abandonnés ? Les policiers ne demandent pas d’éloges creux, ni de médailles distribuées à la hâte après un drame. Ils veulent, tout simplement, que leur engagement ne soit pas jeté dans un vide judiciaire. Lorsqu’un policier arrête un voyou en flagrant délit, qu’il consacre des heures à une procédure soigneusement rédigée, il espère que cette interpellation produira un effet : que la société dise clairement "non" à la délinquance. Pourtant, combien de fois ce même policier voit-il ce voyou ressortir, libre, le lendemain, parfois même dans la même journée ? Quelles leçons, quelles limites, quelles valeurs cela installe-t-il dans la tête de celui qui défie l’ordre ? Aucune ! Pire : cela le renforce dans l’idée que la peur a changé de camp.
Mais alors, pourquoi en est-on arrivé là ?
Les services éducatifs spécialisés ne suffisent plus
Pourquoi la justice paraît-elle si déconnectée des réalités du terrain ? Une part de l’explication réside dans l’épuisement de la chaîne judiciaire. Magistrats, greffiers, substituts croulent sous le poids des dossiers. Les juges des libertés, qui statuent sur les suites d’une garde à vue, doivent le faire dans l’urgence, parfois en quelques minutes. La logique de la quantité a remplacé celle de la qualité. On libère, faute de temps, faute de places en détention, faute d’alternatives crédibles. Le problème devient alors structurel, systémique.
Les prisons et centres de rétention débordent. Les services éducatifs spécialisés ne suffisent plus à encadrer les mineurs violents. Alors la justice, à défaut de mieux, relâche. L’on place des bracelets électroniques, l’on convoque pour des audiences dans trois mois, on fait des rappels à la loi. Mais comment expliquer à un policier blessé, à une victime humiliée, que l’auteur des faits continue sa vie comme si de rien n’était ? Comment construire un sentiment d’appartenance républicaine auprès d'une une jeunesse à laquelle on ne montre jamais les limites claires de l’inacceptable ?
La présomption d’innocence glisse souvent du côté des délinquants
Nos policiers, en première ligne, face aux violences urbaines, aux trafics, aux refus d’obtempérer, aux agressions gratuites agissent avec des moyens limités, vétustes, sous des caméras, sous la pression hiérarchique, sous la menace judiciaire. Lorsque la situation dérape, lorsqu’un usage de la force devient nécessaire, leur parole se voit immédiatement contestée. Toute erreur devient affaire d’État. Une interpellation ferme devient un scandale. La présomption d’innocence glisse souvent du côté des délinquants. Ce déséquilibre fragilise l’autorité. Il pousse à l’autocensure. Il fait naître une peur : celle d’agir, de prendre une décision, d’intervenir. Or, un policier qui hésite devient vulnérable. Et cette vulnérabilité, les voyous la perçoivent. Ils en profitent. Ils la cherchent même. Les politiques, ne doivent plus osciller entre postures et impuissance et les réformes n’aboutissent pas… ou si peu.
La machine reste grippée.
Aujourd’hui, il faut que la hiérarchie policière, parfois éloignée du terrain, remonte fidèlement les signaux d’alerte. Les syndicats crient, mais qui les entend ? Les média se saisissent des cas spectaculaires, mais rarement des situations du quotidien : celles qui usent les nerfs, rongent le moral, abîment la vocation. Dans ce climat délétère et une fatigue morale des policiers se donnent la mort. D’autres changent de métier lorsque d’’autres continuent leur mission, par sens du devoir, le cœur serré, le regard désabusé. Si le danger effraie, ce qui les épuise, c’est de voir le système ne pas suivre. D’observer que les efforts consentis se perdent dans l’indifférence. De savoir que les zones de non-droit s’élargissent et que l’on y entre désormais avec un gilet pare-balles... ou pas du tout.
Repenser toute la chaîne.
Revaloriser la fonction de policier, pas seulement par une vraie reconnaissance institutionnelle. Il faut aussi renforcer les effectifs, les formations, les moyens techniques. Revoir la procédure pénale, aujourd’hui trop complexe, trop lente, trop vulnérable. Mais, ce qui reste essentiel c’est la réconciliation du citoyens avec la justice. Policiers, gendarmes, agents de terrains méritent qu’on entende leurs voix pour prévenir une rupture. Derrière l’uniforme, il y a des femmes et des hommes, parfois jeunes, passionnés, toujours exposés. Les protéger, c’est leur garantir que lorsqu’ils agissent, l’État agit aussi. Lorsqu’ils arrêtent, la justice poursuit. Lorsqu’ils préviennent, la société comprend. Sans cela, nous ne pourrons plus rien demander à ceux qui tiennent encore debout, en première ligne, dans l’attente d’un sursaut.
